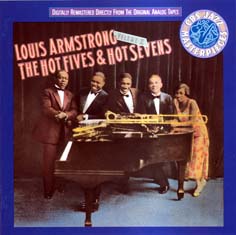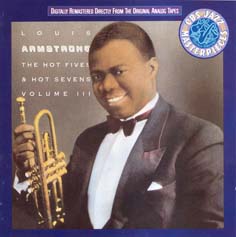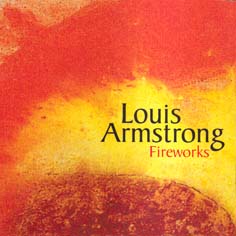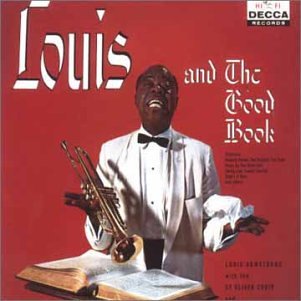Louis Armstrong
Louis Daniel Armstrong est un enfant du
ghetto de La Nouvelle-Orléans. Très jeune, sa mère Maryann (Marie Albert) a
quitté les champs de canne à sucre de Boutte situés à une centaine de kilomètres
à l’ouest de La Nouvelle-Orléans pour entrer au service d’une famille blanche.
Elle fait la connaissance d’un jeune ouvrier agricole qu’elle épouse à l’âge de
quinze ans ; de ce mariage, peu réussi, elle aura deux enfants :
Louis (qui naît un 4 août 1901 ?) et Béatrice. Ses parents se séparent
lorsqu’il a cinq ans ; Louis est élévé par Joséphine, sa grand-mère
paternelle, blanchisseuse. Cette maîtresse femme sait faire swinguer sa cuisine
et ses gâteaux ; Louis se cache sous ses jupes lorsqu’il joue à
cache-cache avec les petits Blancs ; Joséphine l’envoie à l’école, à la
Fisk Scool, de triste réputation, et à l’église où il apprend à chanter le
gospel sous les yeux de son arrière grand-mère. Little Louis retourne chez sa
mère en 1906, lorsque celle ci met au monde un second enfant, Béatrice. Maryann
a besoin d’aide.
La famille Armstrong habite le secteur de
Perdido Street/ Liberty (dans le troisième arrondissement de La
Nouvelle-Orléans), en plein Black Storyville ; ce quartier, pauvre et
rempli de bouges, de dancing miteux, de bordels bon marché, où les marins en perdition
viennent se divertir, est depuis 1898, l’un des premiers endroits du Sud à
abriter la prostitution légale. Il est situé à trois blocs d’immeubles de son
homologue plus huppé, réservé aux riches blancs ou créoles, dont les
pensionnaires sont elles aussi blanches ou créoles. Il a été tacitement reconnu
comme un " district " réservé aux prostituées de couleur et
leurs clients blancs et noirs ; on l’appelle Uptown, le quartier d’en
haut, ce ghetto misérable, qui a été l’un des lieux d’éclosion, sinon le
berceau du jazz. Les musiciens y jouent une musique "chaude" réclamée
par les prostituées et leurs souteneurs, un blues volcanique, sur mesure pour
les slows drags, danses véritables frotte-nombrils, qui ressemblaient à des
copulations à la verticale.
Très tôt, Louis Armstrong se fait remarquer
en "seconde ligne" des fanfares ; celles-ci paradent à travers
La Nouvelle Orléans et se livrent en plein air à des batailles musicales
furieuses. Ces fanfares jouent à la créole et bougent avec sensualité les rythmes
militaires hérités des troupes françaises. Tout au long du cortège, les
"officiels", fans et amis, viennent former une seconde parade,
exulter, gesticuler ; c’est à celui qui se fera remarquer sous la
surveillance d’une police imprévisible. Louis ne perd pas une occasion.
Pour avoir tiré en l’air un coup de
révolver pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 1912, il est envoyé dans un
foyer d’enfants abandonnés, le Waif’s Home, et… entre dans l’orchestre-maison
(dirigé par Peter Davis). Il y joue du tambourin et de divers instruments avant
d’adopter le cornet. A sa sortie, il commence à jouer dans les cabarets de
Storyville et reçoit les conseils de Joe Oliver. En 1918, il entre dans
l’orchestre de Kid Ory, puis sur les riverboats, dans celui de Fate
Marable. Au Lincoln Garden de Chicago, il rejoint Oliver au sein du Creole
Jazz Band comme second cornet. Louis Armstrong, nommé Satchmo (abréviation
de satchmel mouth, bouche en forme de besace), se détache du lot par la
puissance de son jeu alliée à une technique parfaite. Chaque thème qu’il prend
est sublimé. Avec Armstrong, le soliste s’émancipe et devient l’emblème du
jazz.
 En 1924, il est
engagé à New York chez Fletcher Henderson. Durant cette période, il
accompagne de nombreuses chanteuses de blues : Ma Rainey, Trixie Smith,
Clara Smith, Bessie Smith. Il enregistre avec Clarence Williams et Perry
Bradford, retourne à Chicago dans le groupe de Lil Armstrong qu’il a épousée en
1924. A partir de 1925, il enregistre ses
premiers disques en tant que leader à la tête du Hot Five. Il travaille avec
Erskine Tate, abandonne à cette occasion le cornet pour la trompette, passe par
le groupe de Caroll Dickerson, puis celui de Clarence Jones. Il met sur pied en
1927 les Hot Seven pour une série d’enregistrements.
En 1924, il est
engagé à New York chez Fletcher Henderson. Durant cette période, il
accompagne de nombreuses chanteuses de blues : Ma Rainey, Trixie Smith,
Clara Smith, Bessie Smith. Il enregistre avec Clarence Williams et Perry
Bradford, retourne à Chicago dans le groupe de Lil Armstrong qu’il a épousée en
1924. A partir de 1925, il enregistre ses
premiers disques en tant que leader à la tête du Hot Five. Il travaille avec
Erskine Tate, abandonne à cette occasion le cornet pour la trompette, passe par
le groupe de Caroll Dickerson, puis celui de Clarence Jones. Il met sur pied en
1927 les Hot Seven pour une série d’enregistrements.
En 1929, il revient à New York en vedette, accompagné par l’Orchestre de
Luis Russell, participe au Hudson Théâtre de Broadway à la revue de Hot
Chocolate aux côtés de Fats Waller, également signataire des moments
musicaux. Il se produit en soliste au Lafayette Theatre avec l’orchestre de
Caroll Cickerson, puis au New Cotton Club de Los Angeles.
En 1930, il apparaît dans le film Flame.
A a tête d’un grand orchestre, il parcourt les Etats-Unis, se produit à
Broadway et à Harlem. Il
tourne deux courts métrages : Rhapsody in Black and Blue et I’ll
Be Glad When You’re Dead, You Racal You aux côtés de … Betty
Boop.
1932. Il s’embarque sur le Majestic à
destination de l’Europe où il tient la vedette au Palladium de Londres.
De retour aux Etat-Unis, il joue brièvement dans une nouvelle version de Hot
Chocolate, accompagné par la formation de Chick Webb. Nouveau voyage
en Europe, notamment en 1934 à Paris à la Salle Pleyel. Revenu aux Etats-Unis,
où il est devenu une star, Louis Armstrong tourne dans des films comme Pennies
From Heaven avec Bing Crosby (1936), Artists And Models
(1937), Doctor Rhythm-Every Day’s
Holiday avec Mae West (1938), Goin Places (1939), Cabin
In The Sky (1942), Jam-Session –
Atlantic Session (1944), Pillow To Bost (1945). En 1940, il apparaît
à Broadway dans une version musicale du Songe d’une nuit d’été,
intitutée Swinging The Dream. Il est la vedette d’un concert Esquire
donné au Metropolitain Opera avec Roy Eldridge, Jack Teegarden, Coleman
Hawkins, Barney Bigard, Lionel Hampton, Art Tatum, Al Casey, Oscar Pettiford,
Sidney Carlett. Il tourne en 1946dans le film New Orleans.
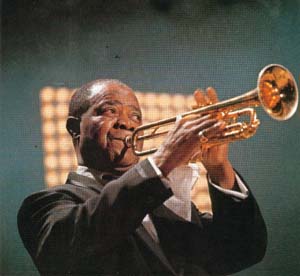 Il abandonne son
grand orchestre et se produit en petite formation au Metropolitan Opera, à Town
Hall. Puis il forme son All Stars qui se présente en 1947 pour la
première fois au club Billy Berg de Los Angeles. 1948, il est une des vedette
du Festival de Nice. 1949, il est sacré roi des Zoulous à l’occasion du Mardi
Gras de la Nouvelle Orleans. Les lecteurs de Downbeat l’élisent « plus
importante figure musicale de tous les temps ». Il passe en vedette au
Festival de Newport, enregistre sa Musical Autobiography, enchaîne le
tournage de nombreux films (A Song Is Born, Courtin’ Trouble, La
Route du Bonheur, High Society, avec Grace Kelly, Bing Crosby
et Frank Sinatra, …)
Il abandonne son
grand orchestre et se produit en petite formation au Metropolitan Opera, à Town
Hall. Puis il forme son All Stars qui se présente en 1947 pour la
première fois au club Billy Berg de Los Angeles. 1948, il est une des vedette
du Festival de Nice. 1949, il est sacré roi des Zoulous à l’occasion du Mardi
Gras de la Nouvelle Orleans. Les lecteurs de Downbeat l’élisent « plus
importante figure musicale de tous les temps ». Il passe en vedette au
Festival de Newport, enregistre sa Musical Autobiography, enchaîne le
tournage de nombreux films (A Song Is Born, Courtin’ Trouble, La
Route du Bonheur, High Society, avec Grace Kelly, Bing Crosby
et Frank Sinatra, …)
Il visite l’Europe chaque année mais se
produit également au Japon (1953), en Australie (1954), au Canada, à la
Jamaïque, en Amérique Latine (1957), en Afrique et en URSS (1965), certaines de
ces tournées étant organisées par le Département d’Etat américain. Ayant été
victime, en 1959, d’n grave malaise à Spoleto, il n’en continue ps moins de se
produire jusqu’à son dernier jour (6 juillet 1971) . Il a fait paraître deux
autobiographies : Swing That Music en 1936 et Ma Nouvelle-Orleans
en 1952.
Louis Armstrong aura tenu, indéniablement,
un rôle capital dans l’histoire de la musique. C’est grâce à lui que la forme
musicale née à La Nouvelle-Orleans à la fin du 19ème siècle atteint
une audience universelle. En fait, il invente le jazz tel que nous le
connaissons aujourd’hui. Alors que les pionniers se bornaient à perpétuer la
folklorique improvisation collective, il va, le premier, se présenter à
l’avant-scène, en gros plan, laissant à ses partenaires le seul soin de lui
fournir un background adéquat. Premier véritable soliste de jazz, il pourra de
cette façon faire sans contrainte montre de son génie d’improvisateur et faire
goûter dans sa plénitude une sonorité incomparable, à la fois cristalline,
ronde et chaleureuse. En outre, alors que les membres des fanfares d’où étaient
issus les premiers musiciens de jazz étaient tenus de placer leurs notes avec
une grande rigueur, Louis Armstrong décale les siennes, soit en avance, soit en
retard sur le temps. L’articulation de sa phrase, que termine un somptueux
vibrato, gagne en légèreté et en souplesse grâce à cette apparente
décontraction génératrice du swing.
Chanteur, Louis Armstrong emprunte la même
démarche. Sa voix rauque, voilée se plie parfaitement aux moindres intentions
d’un musicien d’exception. On remarquera que, comme les grands chanteurs de
blues ou de flamenco, il ne tient pas compte de la structure intime des mots
pris en tant que tel. Rétrécissant ou allongeant à son gré les syllabes,
faisant fi des impératifs de l’accentuation tonique, il ne retient des paroles
que leurs propriétés strictement musicales. Comme tous les jazzmen de sa
génération, Louis Armstrong est, avant tout un spécialiste de la paraphrase. Alors
que l’interprétation des pires tubes à la mode lui fut imposée par les
producteurs de disques, il saura les transfigurer. A l’aide de subtils et insolites décalages, d’accentuations
imprévues, il donne vie, en quelque sorte, à des thèmes qui en étaient
dépourvus ; Kiss of Fire, Ramona, La Vie En Rose,
C’est Si Bon ou le célèbre Hello Dolly, par exemple, deviendront, grâce à son
génie, d’authentiques œuvres de jazz, swingantes à souhait.
C’est ainsi qu’avant d’aborder l’improvisation
proprement dite – qui sera toujours très proche de la trame originales – il imposera sa manière transcendantale. On peut
donc affirmer que tous les musiciens de jazz auront peu ou prou subi son
influence et que ses adeptes sont innombrables. Il est dommage qu’à l’instigation
de ses managers il se soit, sur la fin de sa carrière, voué souvent à un
exhibitionnisme mal venu. Il n’en demeure pas moins que, toutes époques
confondues, il aura gravé quelques uns des chefs-d’œuvre qui donnent au jazz
ses lettres de noblesse. En septembre 1995, l’administration américaine lui a,
enfin, consacré un timbre poste et en 1998, son nom a été donné à une place de
Paris dans le 13ème arrondissement