Miles
Davis
Birth of the Cool
"J'ai
fait la connaissance de Gil Evans à l'époque où il venait écouter Bird.
Ce Blanc grand et mince débarquait avec un sac plein de radis qu'il mangeait avec
du sel. A East Saint Louis, je voyais bien des Noirs entrer avec un sachet
plein de sandwiches de museau de porc grillé qu'ils mangeaient sur place, dans
un cinéma, un club, n'importe où. Mais
qu'un Blanc, coiffé d'une casquette, apporte des radis dans un club à la mode
de la 52e Rue et les mange avec du sel directement dans le sac, ça... ».
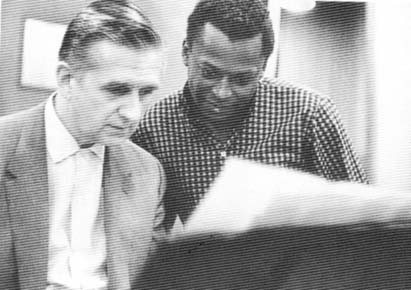 Natif de Toronto,
Canada, Ian Ernest Gilmore Green Evans est un pianiste autodidacte, devenu, en
1941, l'arrangeur attitré de l'orchestre de Claude Thornhill (lui-même
pianiste et arrangeur), l'une des formations favorites de Miles Davis qui ne
lui voit qu'un seul concurrent valable: "Le big band de Billy Eckstine
dans lequel joue Bird."
Natif de Toronto,
Canada, Ian Ernest Gilmore Green Evans est un pianiste autodidacte, devenu, en
1941, l'arrangeur attitré de l'orchestre de Claude Thornhill (lui-même
pianiste et arrangeur), l'une des formations favorites de Miles Davis qui ne
lui voit qu'un seul concurrent valable: "Le big band de Billy Eckstine
dans lequel joue Bird."
Venu
à New York avec Thornhill, Gil Evans a choisi de se séparer de celui-ci, en
1948, afin d'entamer une carrière freelance. Et le sous-sol qu'il occupe sur la
55e Rue, derrière une blanchisserie chinoise, est devenu lieu de passage pour
de nombreux musiciens : John Lewis, Blossom Dearie, Lee Konitz,
Gerry Mulligan, Dizzy Gillespie, et Bird, bien sûr, qui,
une fois de plus sans domicile fixe, va s'y installer pendant quelque temps.
Selon le pianiste et compositeur George Russell, futur inventeur du
concept lydien chromatique d'organisation tonale, également familier des lieux,
"il y avait un grand lit qui prenait presque toute la place, une unique
lampe et une chatte nommée Becky. L'endroit était très sombre. Une fois à
l'intérieur, on oubliait si c'était le jour ou la nuit, l'été ou l'hiver. A
toute heure, des gens allaient et venaient.
Gil, qui adorait être entouré de musiciens, était une vraie mère poule
pour tous, trouvant toujours une réponse réconfortante aux problèmes de
chacun."
Celui
de Miles, justement, est de s'éloigner sensiblement du be-bop et de sa rigoureuse
technicité, afin de définir une approche plus personnelle du jazz. Gil Evans,
qui s'est senti immédiatement des affinités avec ce jeune trompettiste de
quatorze ans son cadet, va alors s'employer à l'y aider. Miles adore le travail
que son nouvel ami a accompli pour Claude Thornhill. Il apprécie
particulièrement la façon qu'a Evans de composer une musique délicate et
raffinée, ne reposant plus uniquement sur le diktat du rythme ou l'agressivité,
et assez proche somme toute de ses propres sensations. Evans, quant à lui, aime
écrire pour des solistes précis.
Son
rêve de collaboration avec Louis Armstrong s'est brisé sur l'entourage
hostile de ce dernier, et l'instabilité chronique de Bird a fait capoter un
certain nombre de ses projets. En Miles, par contre, il a décelé le véhicule
idéal pour mettre enfin en pratique plusieurs de ses idées.
Les
deux hommes décident donc de monter un nonette, version réduite de l'orchestre
de Thornhill, capable de couvrir toute la gamme tonale de celui-ci. Dans ce
but, ils mobilisent de purs boppers comme Max Roach, AI McKibbon
ou John Lewis, mais également Gerry Mulligan, Michael Zwerin
et Lee Konitz : "Beaucoup de Noirs s'en sont pris à moi, disant
qu'ils n'avaient pas de travail et que j'engageais des Blancs. Je leur ai dit
simplement que s'il y en avait un qui pouvait jouer aussi bien que Konitz, je
l'engagerais, et que je me foutais qu'il soit vert à pois rouges. J'engage un
type pour qu'il joue, pas pour sa couleur. Beaucoup m'ont lâché la grappe, mais
certains ont continué de m'en vouloir. " Pour la première fois de sa
carrière, Miles se retrouve en situation de leader. Tandis qu'Evans, Mulligan
et Lewis se partagent les arrangements, il organise les répétitions, convoque
les musiciens et cherche des engagements. Il en obtient enfin un au Royal
Roost, en septembre 1948. Count Basie, dont l'orchestre se produit au
même endroit, en alternance avec le nonette, s'avoue favorablement impressionné
par ce qu'il entend : "Ces trucs lents avaient une sonorité étrange, mais
très juste. Je n'arrivais pas toujours
à suivre ce qu'ils faisaient, mais j'écoutais et j'aimais ça."
Duke
Ellington lui-même s'intéresse de près à l'ancien compagnon
de Bird : "Un jour il envoie un type me chercher. Je me sape donc à mort
et je vais le voir à son bureau. Je frappe à la porte et je trouve Ellington en
short, une femme sur les genoux. Lui que je pensais être la personne la plus
clean, la plus austère de la profession, ça m'a choqué. Il me dit, tout
sourire, qu'il me veut dans son orchestre. Merde, j'étais épaté. Le meilleur big band du business. Mais je
lui ai répondu que je ne pouvais pas, que je devais terminer Birth of the Cool et il l'a compris. Il ne m'en a pas
tenu rancune. Je me suis souvent demandé ce qui serait arrivé si j'étais entré
dans cet orchestre." On peut raisonnablement penser que Miles n'a pas été
tout à fait honnête lors de son entrevue avec le Duke et que la véritable
raison de son refus tient plutôt à sa hantise de jouer la même chose soir après
soir.
 Pourtant, il est
exact qu'il a entamé la confection de ce disque dont l'enregistrement, supervisé
par le chef d'orchestre Pete Rugolo, va s'étaler sur une période de quinze
mois, mais est appelé à changer le son du jazz.
Pourtant, il est
exact qu'il a entamé la confection de ce disque dont l'enregistrement, supervisé
par le chef d'orchestre Pete Rugolo, va s'étaler sur une période de quinze
mois, mais est appelé à changer le son du jazz.
Le
nonette d'origine n'existant plus, un tas de nouveaux musiciens font leur
apparition durant ledit enregistrement, tels le batteur Kenny Clarke, le
pianiste AI Haig, le tromboniste J.J.
Johnson, le contrebassiste Nelson Boyd ou le comiste Gunther
Schuller. Seuls Miles, Mulligan, Konitz et le tubiste Bill
Barber sont présents à toutes les séances.
Trois
au total, dont vont sortir treize plages, qui, d'abord partiellement éditées
sous forme de soixante-dix-huit tours, vont être réunies (à l'exception du
morceau vocal Da That Dream, chanté
par Kenny Haggod), en 1957, sur l'album Birth of the Cool. Mais il faudra attendre 1971, pour que
la version intégrale paraisse enfin sous le titre The Complete Birth of the Cool.
Si
l'audition de ces soixante-dix-huit tours ne rencontre qu'un accueil mitigé du
côté du public éclairé, il n'en va pas de même dans le cercle des musiciens.
Lesquels se montrent sensibles à la nouvelle voie tracée par ce curieux
orchestre qui, après l'âpreté formelle et l'intensité émotionnelle du be-bop,
prône une espèce de sérénité.
Ce
que Miles lui-même appelle le « soft sound », résultat d'un maximum de
relaxation de la part de ses interprètes. Théoricien officiel du be-bop, Dizzy
Gillespie se veut plus nuancé : "Ils jouent moins de notes, moins
vite, ils mettent moins le feu que nous. Le jazz, c'est les tripes. Il faut
suer des couilles dans cette musique.
Eux l'ont un peu adoucie."
C'est
vrai. Mais sans le savoir encore, Miles
Davis vient d'inventer le jazz cool. Dont l'influence va être considérable sur
l'évolution du mouvement West Coast, en majorité blanc, promis à un énorme
succès commercial durant les années cinquante.
Révolution que le pianiste Tadd Dameron, employeur occasionnel du
trompettiste, avait pronostiquée, en affirmant, dès 1949 : "Miles Davis
est le musicien le plus en avance sur son temps."