Le
dernier souffle
"Miles
Davis a choisi de sacrifier au mauvais goût qui définit le rock'n'roll"
écrit en 1990 le poète, batteur et théoricien noir Stanley Crouch dans un
article d'une violence inouïe. Il y accuse notamment le trompettiste de "s'auto-maquereauter",
de la même manière qu'il maquereautait jadis une équipe de prostituées.
"Depuis In A Silent Way, poursuit Crouch, il n'a cessé de
dégringoler, avec sa dégaine de héros d'un film de science-fiction de série B.
Aujourd'hui, il dépasse les bornes en affirmant voir en cette espèce de drag
queen vulgaire qui s'est surnommée Prince la réincarnation de Duke
Ellington."
La
charge est d'autant plus pernicieuse que Stanley Crouch est le mentor de Wynton
Marsalis, dont il rédige tous les textes de pochettes. Mais son opinion, qui
rejoint celle d'un conservateur notoire comme Hugues Panassié, qui, vingt ans
plus tôt, réglait son compte à Miles en trois lignes dans son désopilant
Dictionnaire du jazz ("A tourné délibérément le dos à la tradition musicale
de sa race. Peut être considéré comme
un modèle de l'anti-jazz."), est partagée par un grand nombre de puristes.
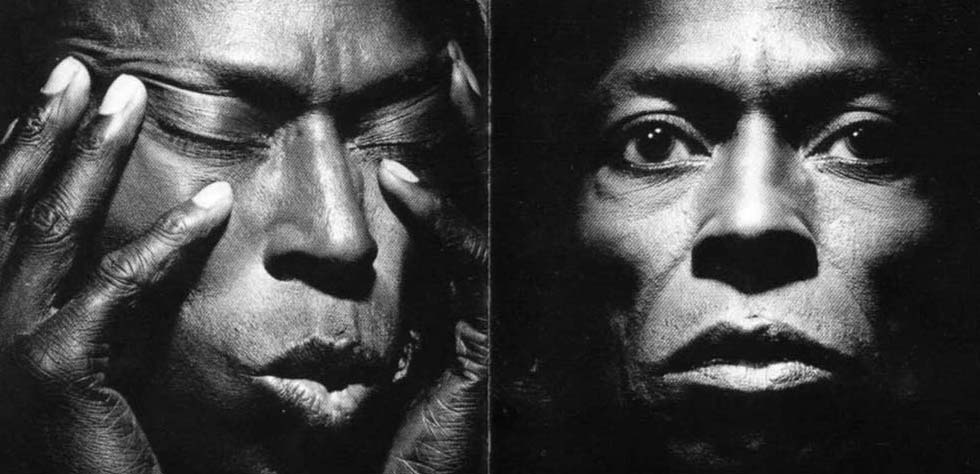 Ainsi, quand Tutu, son premier album Warner, dédié à
l'évêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, est paru, Miles
s'est-il vu accusé de jouer désormais "de la musique d'ascenseur".
"Ce disque ne vaut guère mieux que la B.-O. de Miami Vice, a même écrit un magazine américain, révulsé par la reprise de Perfect Way, tube du groupe pop anglais Scritti
Politti (lequel rendra la politesse à Miles en l'invitant à jouer sur un
morceau de son nouveau disque : Oh Patti).
Ainsi, quand Tutu, son premier album Warner, dédié à
l'évêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, est paru, Miles
s'est-il vu accusé de jouer désormais "de la musique d'ascenseur".
"Ce disque ne vaut guère mieux que la B.-O. de Miami Vice, a même écrit un magazine américain, révulsé par la reprise de Perfect Way, tube du groupe pop anglais Scritti
Politti (lequel rendra la politesse à Miles en l'invitant à jouer sur un
morceau de son nouveau disque : Oh Patti).
Associé,
bien malgré lui, au feuilleton télévisé à succès Miami Vice, Miles, qui s'est découvert un ami
commun avec Don Johnson, l'un des acteurs de la série, en la personne du
chanteur country iconoclaste Willie Nelson (dont il a choisi le nom pour
titrer l'une de ses compositions), fait taire toutes les critiques en
apparaissant dans un épisode de la série, où il personnifie, comble d'ironie,
un proxénète trafiquant de drogue : "Je n'aimais pas trop contribuer à
renforcer la vision stéréotypée que beaucoup de gens ont des Noirs. Alors dans
mon esprit, je ne jouais pas un mac mais un businessman. Cicely m'a dit que j'étais bon. Ça m'a fait
plaisir. J'ai toujours respecté son jugement d'actrice."
En
dépit de ses problèmes de diabète, qui l'obligent à se faire une piqûre
quotidienne d'insuline, Miles se sent bien à l'époque. Les gens l'arrêtent dans
la rue depuis qu'il a tourné un spot publicitaire pour Honda, et, comme au
milieu des années 70, il ne cesse de se produire sur scène et d'enregistrer des
bandes, faisant et défaisant des orchestres au gré de ses inspirations.
Défilent alors à ses côtés les saxophonistes Bob Berg, Gary Thomas, Rick
Margitza, Kenny Garrett; les claviers Robert Irving III, Joe Sample, George
Duke, Adam Holzmann, Kei Akagi; les bassistes Dar-ryl Jones, Benjamin Rietveld;
les guitaristes Billy « Spaceman » Patterson, Foley McCreary, Robben Ford,
JeanPaul Bourelly; les percussionnistes Ricky Wellman, Marilyn Mazur, Omar
Hakim, etc.
A
l'automne 1986, son groupe du moment participe à un gigantesque rassemblement
au profit d'Amnesty International, réunissant, au Giants Stadium, quelques
poids lourds de la pop music. Occasion
pour beaucoup d'aller reluquer de près celui que l'on présente de plus en plus
comme un mutant : "Après notre passage toutes les grandes stars du rock
sont venues me saluer. Les types de U2,
Bono, Sting et ceux de Police, Peter Gabriel, Ruben Blades, toutes sortes de
gens. Certains semblaient avoir la
frousse, et quelqu'un m'a expliqué que c'était à cause de ma réputation de
grossièreté. " Car s'il semble s'être un brin humanisé, Miles Davis n'a
rien perdu de son franc-parler. Invité,
avec Ray Charles, par le président Reagan à la Maison Blanche début 1987, il
crée une mauvaise ambiance après que sa voisine de table lui a dit que sa «
mama » devait être drôlement fière de ce qui lui arrivait : "Ecoutez, ma
mère n'est pas une « mama » de merde, vous entendez ? Ce mot est complètement
ringard, on ne l'utilise plus. Ma mère
était plus élégante, plus convenable, que vous ne le serez jamais. Alors ne dites plus un truc comme ça à un
Noir, pigé ? "
La
mort de Gil Evans, à Mexico, en mars 1988, est un rude coup pour Miles Davis.
Deux mois plus tôt, ils évoquaient encore l'idée de concrétiser un vieux projet
: l'adaptation de La Tosca de Puccini, l'une des ceuvres
lyriques favorites de Miles. Celui-ci dédiera donc à la mémoire du « Maître »
la remarquable B.-O. de Siesta, film tombé aux oubliettes, composée en
collaboration avec Marcus Miller. Parallèlement, il se passionne pour Cameo, le
groupe technosoul de Lan-y Blackmon (qu'il rejoint l'espace d'une plage unique,
In The Night, sur l'album Machismo), pour le zouk antillais de Kassav (dont on
retrouvera la trace dans son album Amandla), et pour
les frères ennemis du funk, Prince et Michael Jackson : "Tous deux sont
formidables, mais je préfère Prince. Il
vient en plein sur le béat et joue par-dessus.
A mon avis, quand il fait l'amour, Prince entend des tambours, pas du
Ravel. Ce n'est donc pas un
Blanc." Le nabot de Minneapolis et le géant d'Alton vont même enregistrer
quelques bricoles ensemble, mais, à l'exception de Sticky Wicked, extrait d'un disque de la chanteuse Chaka Khan, autre
signature de Warner Bros., le résultat de leur rencontre en studio ne sortira
jamais des coffres de Paisley Park.
En
1989, Miles Davis divorce avec Cicely. Ce n'est une surprise pour personne. Depuis
que le trompettiste était revenu au tout premier plan, le ménage ne cessait de
péricliter, et Miles se vantait partout de ne plus partager le lit d'une épouse
qu'il supportait mal depuis plusieurs années: "Cicely a fait des films
dans lesquels elle joue toujours une militante ou du moins quelqu'un de très
concerné par les problèmes des Noirs aux Etats Unis. Ce ne sont que des rôles, hélas. Elle adore en fait cirer les
pompes des Blancs et se range toujours à leur avis." Au même moment, est
publiée son autobiographie, co-rédigée avec le journaliste Quincy Troupe, qui
ne manque pas de causer un certain tapage, Miles s'y dépeignant comme quelqu'un
de rigoureux, d'intransigeant, mais aussi de foncièrement antipathique,
notamment dans ses relations avec la gent féminine. "Comment peut-on
encore parler de génie en présence d'un tel monstre ? " relève aussitôt
l'écrivain féministe Pearl Cleage, suggérant qu'il serait bienvenu de casser
tous les disques de Miles, et même de brûler toutes ses bandes, jusqu'à ce que
celui-ci fasse amende honorable et reconsidère attentivement la question :
"Pouvons-nous, mes soeurs, raisonnablement considérer comme un héros
quelqu'un qui se vante de nous tabasser ? "
Il
y a belle lurette que l'énoncé du problème est dépassé. Miles Davis n'est plus un héros, il est
devenu un Dieu. Cynique, arrogant,
despote pour les uns; timide, fragile, introverti pour les autres. S'entourant
désormais de jeunes musiciens souvent médiocres, que sa présence seule
contribue à transcender: "Si j'aime jouer avec des jeunes, c'est parce que
les vieux jazzmen sont des enfoirés paresseux qui résistent au changement et
s'accrochent aux manières anciennes, trop fainéants pour essayer quelque chose
de différent. Je comprends que des gens me demandent de jouer des trucs comme My Funny Valentine qu'ils écoutaient peut-être pendant
qu'ils baisaient une super fille. Mais
ils n'ont qu'à racheter le disque. Je n'en suis plus là et je dois vivre pour
faire ce qui est bon pour moi, pas pour eux." Son besoin de nouveauté est
tel que, sensible à l'impact croissant du hip hop, il contacte, par le biais du
label Def Jam, spécialisé dans le genre, le rappeur Easy Moe Bee, en
compagnie duquel il enregistre une poignée de thèmes courts, avec des samples
de Kool and the Gang, de Gene Ammons et de YoungHolt Unlimited,
qui seront commercialisés, par Warner Bros., un an après sa mort, sous le titre
Doo-bop.
Pourtant,
le disque qui va le plus marquer les esprits à la fin de la carrière de Miles
Davis est encore une musique de film commandée par le comédien (et en
l'occurrence réalisateur) Dennis Hopper, une vieille connaissance (« Miles m'a
collé un marron le jour où, jeune branleur, j'ai essayé de lui fourguer de
l'héroïne, en disant qu'il me tuerait si
je ni avisais de recommencer
»), au compositeur Jack Nitzsche. Pour
illustrer The Hot Spot, thriller sudiste interprété par Don
Johnson, Nitzsche, exproducteur de Neil Young, a en effet l'idée de réunir en
studio Miles Davis et quelqu'un avec lequel celui-ci n'a apparemment rien en
commun : John Lee Hooker, vénérable bluesman de Clarksdale, Mississippi,
aux accents de griot africain. C'est une inspiration géniale. Au lieu du choc
des continents attendu, c'est à une entente immédiate que l'on est confronté,
grâce à la complémentarité spontanée, communautaire, des deux monstres
sacrés. Preuve qu'en dépit de sa
sophistication extrême, presque caricaturale, la musique de Miles Davis ne
s'est jamais réellement éloignée des racines les plus profondes de l'idiome
afro-américain.
De
cinéma il est encore question avec Dingo, réalisé par
Rolf De Heer, dans lequel, peu de temps avant sa mort, Miles, marié pour les
besoins du scénario à Bernadette Lafont, joue, sous le pseudonyme de Billy
Cross, un trompettiste qui lui ressemble furieusement. D'autant que la musique
originale est pour lui l'occasion de retrouver Michel Legrand, sous la houlette
duquel il avait dé à enregistré une partie de ce qui allait devenir Legrand
Jazz en 1958, en compagnie notamment de John Coltrane, de Bill Evans et de Paul
Chambers.
Le
8 juillet 1991, Miles Davis crée la sensation au festival de Montreux. Soutenu
par une cinquantaine de pupitres placés sous la direction de Quincy Jones,
il se décide à faire ce qu'il avait toujours refusé : jouer la musique du
passé. En l'occurrence celle écrite pour lui par le fidèle Gil Evans. Extraits de Miles Ahead, de Porgy and Bess, de Sketches of Spain, le public du Palais des Festivals
assiste, fasciné, à cette incroyable remontée dans le temps que Miles lui-même,
heureusement soutenu par sa doublure Wallace Roney, a le plus souvent du
mal à maîtriser. A soixante-cinq ans, jamais le trompettiste n'a paru aussi
frêle ni vulnérable. Sous cette perruque invraisemblable qu'il arbore depuis le
milieu des années quatre-vingt afin de dissimuler sa calvitie, et qui a pour
effet d'affiner encore le masque de douleur qui lui sert désormais de visage,
seuls les yeux, immenses, aux pupilles dilatées, ont conservé intact ce feu qui
l'a toujours habité. La peau, elle, paraît de plus en plus lisse, tirée, comme
si elle était peu à peu aspirée de l'intérieur. Contrairement à ce que prétend Stanley Crouch, ce n'est pas à un
héros de science-fiction que ressemble désormais Miles, mais plutôt à un
extra-terrestre. Croisement hasardeux
entre Maître Yoda et un voltigeur alien.
Le
grand public ne le sait pas encore mais Miles, lui, n'ignore pas que le compte
à rebours a commencé. Un an plus tôt il
a appris qu'il était condamné. Sida. Comme des centaines d'anciens junkies qui doivent
affronter la maladie après coup, parfois des années après avoir décroché, Miles
a été probablement victime d'une aiguille douteuse. C'est bien sûr l'unique raison qui l'a poussé à accepter de
cautionner, après treize années de résistance acharnée, l'opération
montreusienne. A laquelle succèdent, deux jours plus tard, des retrouvailles
parisiennes, dans le cadre du festival de la Villette, avec Herbie Hancock,
Chick Corea, Joe Zawinul, John McLaughlin, Jackie
McLean, Dave Holland, Al Foster et Wayne Shorter. Comme si Miles avait décidé de faire la
tournée des popotes avant de repartir au feu, pour une dernière bataille qu'il
savait perdue d'avance. Début août, c'est un homme usé qui souffle son ultime
chorus sur la scène du Hollywood Bowl de Los Angeles. Il allait encore plus mal qu'à Paris, dira Wayne Shorter, témoin
du concert, c'est la première fois que je le voyais dans un tel état de
fatigue.
Plusieurs
fois démentie, la rumeur de l'hospitalisation de Miles au St. Johns Hospital de
Santa Monica, non loin de la maison qu'il a achetée à Malibu, est enfin
confirmée mi-septembre. Sans que l'on parvienne à savoir s'il a sombré ou non
dans le coma. Le 28, New Musical
Express publie, sous le titre Sketches of
Pain, une brève non signée, annonçant que Miles est en train de mener un
combat perdu contre le sida dans un hôpital californien. C'est la première fois
que le nom de la terrible maladie est évoqué à propos du trompettiste, et le
monde musical réagit d'abord avec incrédulité. Mais vingt-quatre heures après
la parution de l'hebdomadaire anglais, la nouvelle tombe sur tous les
téléscripteurs du globe : Miles Davis vient de s'éteindre. Raisons officielles : pneumonie, déficience
respiratoire et arrêt cardiaque.
«
L'homme noir qui vivait comme un homme blanc », pour reprendre une expression
d'Ornette Coleman, celui qui disait en souriant à son ami l'écrivain
James Baldwin, des années auparavant, "Je devrais être mort depuis
longtemps, mais la drogue ne m'a pas tué et je n'ai donc plus rien à craindre",
s'est donc trompé. Il a été rattrapé
par Thanatos, mélomane incontesté, au moment où il s'y attendait le moins et
repose désormais au cimetière de Woodlaw, à New York, en face de la tombe de Duke
Ellington. Pourtant, Miles n'avait pas entièrement tort quand il
s'imaginait immortel. "La musique est à la fois une bénédiction et une
malédiction, avait-il coutume d'affirmer, mais je l'adore et je ne m'imagine
pas vivant d'autre chose." Or, s'il ne vit plus de sa musique, Miles Davis
continue de vivre à travers elle. Pour
une raison bien simple, jadis révélée par le batteur Chico Hamilton :
"Miles n'est pas un homme de spectacle. Ce n'est même pas un trompettiste.
Miles est une sonorité. Le chant de la planète entière." Et celle-ci n'en
a pas fini de tourner.