La
révolution électrique
En
1966, Clive Davis est devenu vice-président et directeur général de Columbia,
compagnie phonographique avec laquelle Miles Davis est sous contrat
depuis 1955. Miles a d'ailleurs assisté à l'ascension de son homonyme, entré dans
la maison à titre de conseiller juridique en 1960. A peine en fonction, Clive
Davis se singularise en signant avec un maximum de stars de la pop music: Donovan,
Laura Nyro, Janis Joplin, Blood, Sweat and Tears, Johnny
Winter. Ce dernier obtiendra même,
en 1969, une avance record de trois cent mille dollars sur ses six albums à
venir.
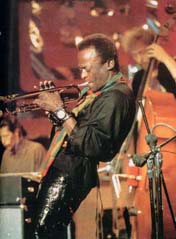 Face à une telle
concurrence interne, la position de Miles devient vite intenable, qui se
retrouve rangé d'office dans la catégorie des musiciens dits
"sérieux". Situation insupportable pour lui. "Devenu star du
jazz, Miles avait développé des goûts dispendieux", confiera Clive Davis à
la revue Downbeat en 1974. "Cela commença à poser des problèmes à la
société.
Face à une telle
concurrence interne, la position de Miles devient vite intenable, qui se
retrouve rangé d'office dans la catégorie des musiciens dits
"sérieux". Situation insupportable pour lui. "Devenu star du
jazz, Miles avait développé des goûts dispendieux", confiera Clive Davis à
la revue Downbeat en 1974. "Cela commença à poser des problèmes à la
société.
Il
réclamait régulièrement des avances, alors que nous ne faisions plus le moindre
bénéfice sur ses ventes de disques." Le jazz est alors effectivement en
pleine crise et ne supporte pas la comparaison commerciale avec la pop, dont le
public se veut plus proche de la Great Black Music militante d'Albert Ayler et
de l'Art Ensemble of Chicago que d'un style musical plus conventionnel qu'il
juge à la fois "bourgeois" et "conservateur".
Intraitable,
Miles Davis continue de tirer à boulets rouges sur la « new thing ».
"Putain, mec! Si un truc te paraît
mauvais, il ne faut rien avoir dans les tripes pour dire que c'est bon ! "
s'exclame-t-il ainsi devant Leonard Feather, à l'audition de The Funeral d'Archie Shepp. "Je
trouve ça mauvais et je refuse de l'écouter plus longtemps."
Ironie
du sort, une même affiche réunit Shepp et Miles à Londres en 1967. Le
trompettiste exige que sa formation passe en première partie, par crainte de
jouer devant un public écoeuré. Pourtant c'est l'inverse qui se produit. Tandis
que Miles, en smoking et noeud papillon, n'obtient qu'une réaction polie,
Archie Shepp déchaîne les passions notamment auprès de la jeune génération,
aussi sensible à l'aspect vestimentaire extravagant de son orchestre qu'à une
musique off-rant des'sensations proches de celles que peuvent transmettre les
groupes de rock contemporains. Miles est donc le grand perdant de cette espèce
de querelle entre les anciens et les modernes qui ne veut pas dire son nom.
De
plus en plus agacé, Miles dénonce désormais en permanence la « politique
injuste » menée par sa propre maison de disques qui préfère pousser des «
groupes d'imitateurs » comme Blood, Sweat and Tears ou Chicago
Transit Authority, qui vendent par conséquent des millions d'albums, au
détriment des authentiques créateurs dont idées et répertoires sont
systématiquement pillés. "Si vous cessiez de m'appeler jazzman et si vous
mettiez mes disques dans les mêmes bacs que ces enfoiréslà, peut-être se
vendraient-ils mieux", téléphone-t-il un jour, furieux, à Clive Davis.
En
même temps, sous l'influence de Betty, il écoute énormément James Brown,
Jimi Hendrix (qu'elle lui a présenté), The Fifth Dimension ou Sly
and the Family Stone : "Le rock est une musique sociale. Il en existe
deux versions distinctes : la blanche et la noire.
 Tandis que des
parvenus noirs s'efforcent de blanchir leur façon de chanter, les Blancs font
tout pour essayer de sonner noir. Ça devient embarrassant. D'autant que les
groupes de rock qui comptent vraiment, comme The Jimi Hendrix Experience ou Sly
and the Family Stone, prônent l'intégration raciale." Ce nouvel intérêt de
Miles pour une musique plus électrique est déjà perceptible dans Filles de Kilimandjaro, album au générique duquel, outre le
quintette habituel, figurent deux invités : le contrebassiste anglais Dave
Holland et le pianiste Chick Corea, lequel se voit sommé d'utiliser
abondamment un Fender Rhodes, la nouvelle lubie du trompettiste : "Le
piano acoustique est un instrument dépassé.
Il appartient à Beethoven et ne correspond plus à notre époque."
Tandis que des
parvenus noirs s'efforcent de blanchir leur façon de chanter, les Blancs font
tout pour essayer de sonner noir. Ça devient embarrassant. D'autant que les
groupes de rock qui comptent vraiment, comme The Jimi Hendrix Experience ou Sly
and the Family Stone, prônent l'intégration raciale." Ce nouvel intérêt de
Miles pour une musique plus électrique est déjà perceptible dans Filles de Kilimandjaro, album au générique duquel, outre le
quintette habituel, figurent deux invités : le contrebassiste anglais Dave
Holland et le pianiste Chick Corea, lequel se voit sommé d'utiliser
abondamment un Fender Rhodes, la nouvelle lubie du trompettiste : "Le
piano acoustique est un instrument dépassé.
Il appartient à Beethoven et ne correspond plus à notre époque."
Amplifiant
lui-même sa trompette reliée à une pédale wahwah, Miles à vrai dire ne fait que
reprendre à son compte une théorie précédemment développée par son ancien
tromboniste, Mike Zwerin, reconverti dans le journalisme. Dès 1966, celui-ci écrivait en effet dans
Rolling Stone : « Il va falloir que le jazz apprenne à faire des concessions au
monde du rock et à l'électronique, s'il compte demeurer un reflet crédible de
la vie moderne. »
En
août 1968, Tony Williams quitte Miles afin de fonder le trio Lifetime,
avec le guitariste John McLaughlin et l'organiste Larry Young. Il s'agit là du premier groupe officiel d'un
nouveau genre que l'on va bientôt baptiser jazz rock. Miles l'a remplacé par Jack DeJohnette, mais au moment
d'entrer en studio, en février 1969, il ne peut s'empêcher de le rappeler: « Je
tenais absolument au son de Tony. Il
est venu à ma demande avec John McLaughlin qui assurait comme un fou, afin de
rejoindre Wayne, Chick, Herbie, Dave et Joe Zawinul que j'avais découvert au
piano électrique sur le Mercy,
Mercy, Mercy de Cannonhall
Adderley. »
L'album
qui sort de cette session s'intitule In a Silent Way, du nom d'une composition de Zawinul, justement, et illustre à la
perfection la nouvelle orientation musicale de Miles Davis. Car avec cet album, Miles est conscient d'avoir enregistré quelque chose
d'exceptionnel, susceptible, qui plus est, de lui rendre son statut de
perpétuel pionnier. Il ne se trompe
pas. Dès sa parution, le disque est
encensé par la critique et, grande première, il bénéficie également des
commentaires élogieux de la presse rock.
Conséquence, à la fin de 1969, Miles est consacré « Jazzman de l'année
». Clive Davis, qui a immédiatement flairé le bon filon, lui propose alors de
se produire dans des temples de la musique pop, afin d'y aller chercher un
nouveau public : « Quand il m'a annoncé ça, j'ai piqué une crise et je lui ai
raccroché au nez. J'étais déterminé à
changer de compagnie phonographique.
Motown m'intéressait. Mais chez
Columbia on n'a pas voulu me lâcher. »
Le
climat n'est donc pas très sain quand Miles enregistre Bitches Brew, double-album qui va avoir le même impact auprès de la jeune
génération que le Electric
Ladyland de Jimi
Hendrix, le Absolutely Live
des Doors ou le Wheels of Fire de Cream et se vendre en un mois à plus
de soixante-dix mille exemplaires, chiffre impressionnant pour un disque de
jazz. Le commentaire de Rolling
Stone est particulièrement enthousiaste et, cette fois, Miles accepte de
céder aux caprices de Clive Davis. Au Fillmore West de San Francisco, son
groupe ouvre donc pour le Grateful Dead. Occasion pour le trompettiste
de sympathiser avec le guitariste Jerry Garcia, fanatique de jazz et ami
intime d'Ornette Coleman et Bill Evans. Il partagera ensuite
l'affiche avec Carlos Santana (coltranien convaincu), Crosby, Stills,
Nash et Young, et même Steve Miller, qui lui tape particulièrement
sur les nerfs : "Ça me gonflait de jouer en première partie de cet enfoiré
qui emmerdait tout le monde, juste parce qu'il avait sorti un ou deux
disques."
Betty
Mabry (qui fait désormais carrière sous le nom de Betty Davis) l'ayant trompé
avec Jimi Hendrix, Miles décide, à la même époque, de divorcer : "Quand je
lui ai annoncé la nouvelle, elle m'a répondu que, belle comme elle était, je ne
pouvais pas laisser tomber un coup pareil. J'ai répondu à cette salope qu'elle
avait intérêt à signer en vitesse les papiers qui étaient prêts sinon ça allait
chauffer pour son matricule. Elle a
signé et ça a été terminé." Quelques semaines plus tard, Miles qui
s'affïche, au volant de sa Ferrari, en compagnie de sa dernière conquête,
Marguerite Eskridge, se fait tirer dessus par trois Noirs inconnus qui prennent
la fuite dans leur propre véhicule. Appelée sur les lieux, la police fouille sa
voiture et embarque Miles sous prétexte qu'elle a trouvé de la marijuana. Il
sera finalement relâché, faute de preuves : "J'ai appris ensuite que l'on
m'avait pris pour cible parce que des Noirs qui montaient des concerts à
Brooklyn étaient furieux que les organisateurs blancs contrôlent tous les
engagements. On m'a dit aussi que celui qui avait tiré s'était fait descendre
par quelqu'un qui n'avait pas apprécié son geste."
Ponctué
par une apparition au festival de l'île de Wight, le Woodstock anglais,
réunissant le gratin pop du moment (les Who, les Doors, Jimi Hendrix, Jethro
Tull, Ten Years After, Leonard Cohen ... ), le début des années soixante-dix
correspond à une période d'intense activité pour Miles Davis. Il enregistre abondamment, embauchant sans
cesse de nouveaux musiciens (les batteurs Billy Cobham, Lenny White,
Al Foster, les saxophonistes Steve Grossman, Gary Bartz, Dave
Liebman, Azar Lawrence, les pianistes Keith Jarrett, Harold
Williams, les guitaristes Dominique Gaumont, Reggie Lucas, Sonny
Sharrock, le bassiste Michael Henderson, les percussionnistes Airto
Moreira, M'Tume, etc.) afin de pousser ses expérimentations toujours plus loin. Mêlant étroitement des éléments empruntés au
funk, au rock, au jazz, à la future world, sa musique inclassable (certains
avanceront le terme de «space music») ne ressemble à rien de ce qui pouvait
exister auparavant : "Les jeunes l'ont bien compris et cette musique les
botte. Ils ne veulent plus de toutes ces conneries qu'on s'obstine à leur
balancer. C'est pour ça que nous jouons autre chose, pas pour être des stars de
la musique pop ni pour nous vendre à ces putains de jeunes. Je ne me suis vendu
à personne."
C'est
certain. Mais il n'empêche que Miles Davis est réellement devenu une star de la
musique pop, ce que tout son comportement(attitude scénique, garde-robe à base
de cuir et de fourrure, invraisemblable collection de lunettes noires,
bracelets, colifichets) confirme. Un chef de file aussi, puisque tous ses
anciens compagnons, ceux que l'on surnommera « les enfants de Miles »,
s'efforcent de développer ses concepts de leur côté. Le Tony Williams
Lifetime casse la baraque, Wayne Shorter et Joe Zawinul sont partis fonder Weather
Report, Chick Corea a monté Return to Forever avec Lenny White, John
McLaughlin et Billy Cobham vont bientôt créer le Mahavishnu Orchestra,
Herbie Hancock travaille le concept Headhunters. Seul Dave Holland n'a
pas suivi cette filière, qui a choisi de s'acoquiner avec le mouvement
avant-gardiste britannique.
Parmi
les disques qui ne cessent de sortir, comme si Miles était pris d'une espèce de
frénésie vinylique, trois références sont particulièrement séduisantes : A Tribute to Jack Johnson, bande-son d'un film de William Cayton retraçant la vie d'un immense
boxeur noir du début du siècle, champion du monde des poids lourds de 1908 à
1915, auquel Miles Davis vouait une admiration sans retenue; On the Corner, présenté comme une sorte de fusion
urbaine des musiques de Sly Stone et de Karlheinz Stockhausen, et résultat
d'une rencontre avec l'arrangeur anglais Paul Buckmaster (futur collaborateur
d'Elton John); Get Up
With It, au climat plus
sombre, dédié à la mémoire de Duke Ellington.
Beaucoup
d'amateurs de jazz, pourtant, boudent Miles Davis dont ils jugent la musique et
le comportement par trop atypiques. Celui-ci, qui a replongé dans l'alcool et
la cocaïne, est par ailleurs confronté à des tas de problèmes personnels. C'est
d'abord l'une de ses locataires qui le traîne au tribunal en l'accusant de l'avoir
giflée. A l'audience, le prévenu est innocenté mais la presse a monté l'affaire
en épingle sous le titre : Miles Davis frappe une femme blanche. Il subit
ensuite une nouvelle opération de la hanche qui l'éloigne de la scène pendant
plusieurs semaines, puis, après s'être endormi au volant de sa Lamborghini sur
West Side Highway, il est victime d'un terrible accident dont il sort vivant
par miracle, les deux chevilles brisées. En 1975, malade (il a dû, en outre, se
faire soigner pour un ulcère aigu), artistiquement vidé, Miles décide de
raccrocher : "Je n'avais plus rien à dire musicalement et je passais mon
temps dans les hôpitaux. Je commençais à lire de la pitié dans les yeux des
gens qui me regardaient, comme à l'époque où j'étais junkie. J'ai préféré laisser
de côté la chose que j'aimais le plus au monde, ma musique, jusqu'à ce que je
puisse la reprendre en main convenablement."