1941-1961 : Days of 41
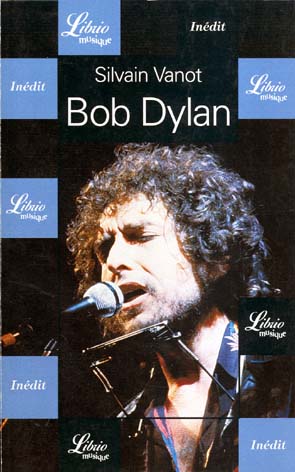 Robert
Allen Zimmerman naît le 24 mai 1941 à Duluth, Minnesota. Ses parents, Abraham
Zimmerman et Beatty Stone, sont issus de l'émigration juive qui a fui les pogroms
d'Europe de l'Est à la fin du XIXème siècle. Abraham est employé dans une
grande compagnie pétrolière, mais il contracte la polio en 1946, peu de temps
après la naissance d'un deuxième fils : David. Les Zimmerman déménagent alors
vers Hibbing, à cent kilomètres de là, une cité minière où réside la mère de
Beatty. Après une convalescence de six mois, Abraham travaille avec deux de ses
frères qui ont ouvert un magasin de meubles et d'appareils ménagers. La
famille s'installe alors dans une maison indépendante et mène une vie sans
luxe, mais relativement aisée. Bobby a une enfance sans histoires. C'est le
chouchou de ses grands-mères. Il est plutôt calme et effacé, sauf lorsqu'il
chante pendant les réunions de famille : là, il s'anime et prend un plaisir
évident à être applaudi. Il écrit des poèmes pour sa mère, suit les feuilletons
populaires à la radio et reste souvent seul. Hibbing a accueilli des gens venus d'Europe du Nord, en majorité
chrétiens, les Juifs y sont très peu nombreux. Bobby ne sort qu'avec les siens
et observe les traditions: il fait sa bar-mitsva devant toute la communauté
juive de la région rassemblée pour l'occasion.
Robert
Allen Zimmerman naît le 24 mai 1941 à Duluth, Minnesota. Ses parents, Abraham
Zimmerman et Beatty Stone, sont issus de l'émigration juive qui a fui les pogroms
d'Europe de l'Est à la fin du XIXème siècle. Abraham est employé dans une
grande compagnie pétrolière, mais il contracte la polio en 1946, peu de temps
après la naissance d'un deuxième fils : David. Les Zimmerman déménagent alors
vers Hibbing, à cent kilomètres de là, une cité minière où réside la mère de
Beatty. Après une convalescence de six mois, Abraham travaille avec deux de ses
frères qui ont ouvert un magasin de meubles et d'appareils ménagers. La
famille s'installe alors dans une maison indépendante et mène une vie sans
luxe, mais relativement aisée. Bobby a une enfance sans histoires. C'est le
chouchou de ses grands-mères. Il est plutôt calme et effacé, sauf lorsqu'il
chante pendant les réunions de famille : là, il s'anime et prend un plaisir
évident à être applaudi. Il écrit des poèmes pour sa mère, suit les feuilletons
populaires à la radio et reste souvent seul. Hibbing a accueilli des gens venus d'Europe du Nord, en majorité
chrétiens, les Juifs y sont très peu nombreux. Bobby ne sort qu'avec les siens
et observe les traditions: il fait sa bar-mitsva devant toute la communauté
juive de la région rassemblée pour l'occasion.
À Hibbing, les
puits de mine ferment les uns après les autres et l'ambiance est plutôt morose.
Les Zimmerman font sensation en achetant un des premiers postes de télévision
de la ville, mais les programmes pour la jeunesse sont aussi rares qu'inintéressants.
Alors, pour tromper l'ennui, Bobby se met à la musique.
Il pianote à
l'occasion de visites en famille et achète une guitare bon marché après avoir
tâté de la trompette et du saxophone. Comme tout le monde à l'époque il adore
la country et pardessus tout son roi : Hank Williams. Mais en bon
"teen-ager" il se cherche bientôt des modèles d'un nouveau
genre. James Dean est sa première vraie idole. La jeune vedette incarne,
grâce à ses choix de comédien, l'incompréhension dont souffrent les adolescents.
Bobby est un des premiers au collège à s'acheter un blouson rouge comme son
héros dans La Fureur de vivre.
Dean meurt en
1955, dans l'accident de voiture qui le fait entrer dans la légende. Mais, à la
même époque, une nouvelle star va bouleverser toute la jeunesse occidentale,
Bobby en tête: «Entendre Elvis pour la première fois c'était comme s'échapper
de prison. Longtemps pour moi la liberté ça a été de l'écouter chanter Blue Moon of Kentucky ». Elvis Presley
interprète parfois des standards du. music-hall et de la country, mais avec une
spontanéité qui frôle la provocation. Et il y a pire : non seulement il chante
des morceaux écrits par des Noirs, mais il les chante comme eux! C'est plus
qu'il n'en faut pour séduire un adolescent anticonformiste. La ségrégation est
encore légale à l'époque. Un organisme comme le Conseil de citoyens blancs de
l'Alabama peut impunément déclarer dans un communiqué: « Le rock'n'roll est
sexuel, immoral et favorise le rapprochement entre les races. »
Bobby aime les rockers blancs (il verra même Buddy Holly
sur scène trois jours avant son accident d'avion fatal, début 1959), mais il
leur préfère Little Richard, le cauchemar d'Abraham Zimmerman : un Noir
à la sexualité ambiguë qui hurle des onomatopées en jouant du
piano avec les pieds! Et comme si ce n'était pas suffisant, Bobby partage cette
passion avec une jeune fille, Echo Hestrom, dont les parents sont pauvres et
chrétiens.
À la même époque,
il fait ses premiers pas de rocker dans des groupes de teen-agers : les
Jokers, les Shadow Blasters, les Golden Chords, Elston Gunn & the Rock
Boppers... Des groupes de reprises dans lesquels il chante et joue, d'abord du
piano, puis de la guitare. Les adultes détestent, les jeunes adorent, les
filles surtout. Bobby en profite, quitte à froisser Echo qui va d'ailleurs
finir par rompre. La nuit, il capte les radios noires qui diffusent du rythm'n'blues,
une musique qui normalement n'intéresse guère les Blancs de son âge. Il se
lasse progressivement du rock'n'roll qui, depuis l'incorporation d'Elvis, est
devenu inoffensif, joué par de gentils garçons comme Fabian ou Frankie
Avalon. Il se rend souvent à Minneapolis et Saint Paul, les métropoles les
plus proches où il voit des concerts et fréquente de jeunes Noirs, en cachette
de ses parents. Il s'oppose surtout à son père qui désapprouve tous ses choix :
en matière de musique, comme en amitié et en amour. Bobby ne supporte plus
l'esprit petit-bourgeois de son père. Difficile pourtant de parler de rébellion
: il sait se rendre aimable quand c'est nécessaire... à 16 ans, il réussit à
obtenir de lui une moto puis une voiture. Deux moyens supplémentaires pour
jouer les jolis cœurs, quitter plus souvent Hibbing et... frôler la mort dans
des accidents à répétitions.
Il s'intéresse de
plus en plus au folk. Lors de la fête qui suit l'obtention de son diplôme de
fin d'études secondaires, des amis de ses parents lui ont offert des 78 tours
de Leadbelly. L'authenticité du blues acoustique du vieux maître le
séduit tout de suite. De plus, la réputation sulfureuse de Leadbelly,
emprisonné pour meurtre, fascine ce jeune rebelle qui depuis toujours se
passionne pour les hors-la-loi. Il écoute aussi la chanteuse noire Odetta et
Harry Belafonte, deux artistes qui ont popularisé le blues traditionnel
auprès du public blanc de l'époque. Cet été 1959, il sacrifie au rock'n'roll
une dernière fois: il rejoint Bobby Vee, un jeune émule de Buddy
Holly qui aura son heure de gloire au début des années 1960. Bobby Vee et
son groupe les Shadows sont des semi-professionnels. Bob les a convaincus de le prendre comme pianiste,
mais l'expérience est de courte durée: les pianos sont rares dans les clubs. Il
ne joue pas aussi bien qu'il l'avait dit et a une fâcheuse tendance à venir à
l'avant-scène pour taper dans ses mains! Dans son désir de liberté et
d'émancipation il se cache derrière un pseudonyme. Après Elston Gunn, il
choisit Bob Dillon, patronyme très courant dans le Midwest, puis change très
vite pour Dylan. Bobby Zimmerman apprécie le poète gallois Dylan Thomas,
son œuvre mais aussi l'aura maudite de l'alcoolique mort en 1953, à l'âge de 39
ans. Il restera pourtant toujours allusif sur les raisons qui ont motivé ce
changement. À un journaliste pressant il répondra que ce choix a surtout
profité à la notoriété de Thomas Dylan! Abraham Zimmerman, lui, est furieux. Il
ne comprend pas pourquoi son fils ne veut pas porter son nom. Il le sera plus
encore lorsque Bobby changera d'état civil, le jour même de ses 21 ans!
Totalement
dépassé, incapable de communiquer avec son fils aîné, Abraham l'envoie dans une
curieuse institution. Une sorte de cours d'été de redressement censé remettre
Bobby dans le droit chemin. Le séjour ne dure que quelques semaines, mais finit
de braquer l'adolescent contre l'autorité paternelle. À la rentrée
universitaire de 1959, Bobby s'installe à Minneapolis, dans le quartier bohème
de Dinkytown. Il feint de suivre des études d'art pour rassurer ses parents,
mais se consacre à la musique. Il se produit seul dans des bars du quartier.
Il est épaté par la petite intelligentsia de Dinkytown. Il traîne souvent avec
David Whitaker, un fumeur de marijuana partageur qui a roulé sa bosse et
qui a rencontré les écrivains de la Beat generation : William Burroughs,
Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Whitaker encourage Bobby à persévérer. C'est
sans doute chez lui qu'il découvre l'album de Woody Guthrie intitulé Dust Bowl Ballads.
Guthrie est une
figure historique. Il est né en 1912 à Okemah, un trou perdu de l'Oklahoma. À
16 ans, orphelin, il est parti sur les routes sans un sou. Il suffit de lire Les
Raisins de la colère de Steinbeck pour avoir une idée de ce qu'a pu
être l'existence de ces vagabonds que l'on appelait des «
hoboes ». Engagé politiquement,
Guthrie a écrit plus d'un millier de chansons très inspirées
du blues noir et du folklore anglais ou irlandais. Sur sa guitare on pouvait lire
un slogan devenu fameux: «Cette machine tue les fascistes ». Avec son morceau
le plus célèbre, This Land Is Your Land, il a
donné une dignité aux petites gens et aiguisé leur conscience politique. Il
était résolument à gauche, à un point tel que sa ville natale se refuse encore
aujourd'hui à honorer dignement sa mémoire.Après la découverte fulgurante du
disque de Guthrie, Bobby lit son autobiographie: Bound for Glory. C'est
une révélation. Il dévore le livre puis se jette sur le reste de l'œuvre de sa nouvelle
idole: il apprend deux cents de ses chansons. Il prend ses inflexions de voix,
porte la même casquette que lui. Il s'exerce à jouer de l'harmonica en s'accompagnant
à la guitare grâce à un porte-harmonica. Plus tard, il prétendra parfois être
passé au folk pour plaire aux filles. En réalité, depuis sa découverte
d'Odetta, il est fasciné par cette musique. Guthrie finit de le convaincre,
mais pas uniquement pour des raisons politiques. Le jeune Dylan admire la
simplicité efficace de sa poésie, mais aussi son style de vie marginal et son
donjuanisme effréné.
Il est tombé
amoureux d'une jeune actrice charmante, Bonnie Jean Beacher, elle aussi
passionnée de blues. Deux ans plus tard, elle lui inspirera une magnifique
chanson de nostalgie amoureuse, Girl from the North
Country. Pour l'instant, il lui parle parfois de mariage et d'enfants,
mais ça ne l'empêche pas d'aller voir ailleurs. Comme Guthrie, il prend toutes
sortes d'arrangements avec la morale bourgeoise. Il lui arrive ainsi de
subtiliser des collections de disques chez les gens qui l'accueillent. Suivant
l'exemple de Guthrie et Kerouac, il prend la route pendant l'été 1960 et se
retrouve à Denver dans le Colorado. Là, il rencontre Jesse Fuller, le
bluesman homme-orchestre de San Francisco. Dylan prétendra longtemps avoir
connu Woody Guthrie et croisé de nombreux maîtres bluesmen quand il était
adolescent. En réalité, Jesse Fuller est le premier musicien influent qu'il
fréquente. Ce qui n'est pas si mal si l'on considère qu'il a tout juste 19 ans.
De retour à
Minneapolis, après un crochet à Hibbing - la taille provinciale de la ville le
désespère -, il a le plaisir d'être félicité par Odetta qui l'a vu jouer dans
un café, mais cela n'est pas suffisant. Il veut partir pour New York. C'est là,
dans le quartier bohème de Greenwich Village que le folk est le plus excitant.
Et puis, il sait désormais que Guthrie est hospitalisé, depuis 1952, dans la
banlieue de New York, et il est décidé à lui rendre visite. En décembre, il
quitte donc Minneapolis. Il fait d'abord une étape galante à Chicago, puis
s'arrête à Madison dans le Wisconsin où il assiste à un concert de Pete Seeger,
un chanteur-banjoïste très engagé, compagnon de route de Woody Guthrie. Cela
l'incite à poursuivre l'aventure. Mais le voyage coûte cher. Coup de chance! Il
rencontre Fred Underhill, un étudiant en route pour New York. Ce dernier a
trouvé une place dans une voiture et cherche un autre passager pour partager le
volant.