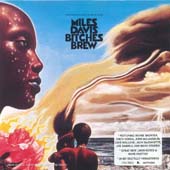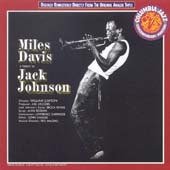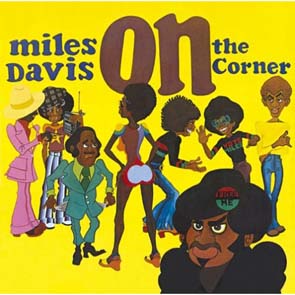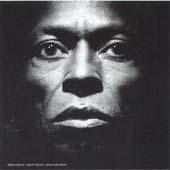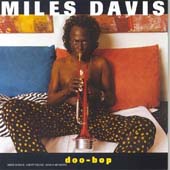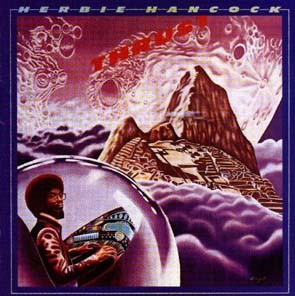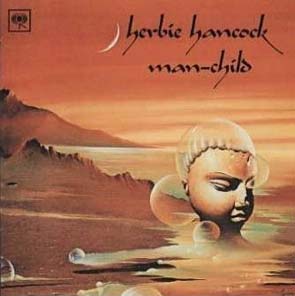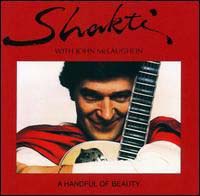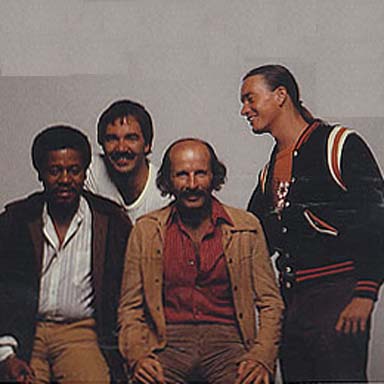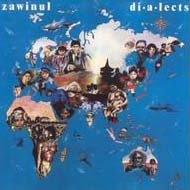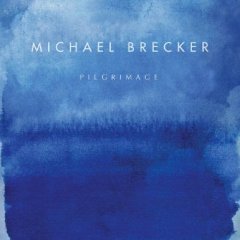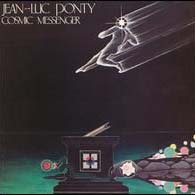Le jazz traversa une crise économique à la
fin des années 1960. Les publics plus jeunes accordèrent leur préférence à la
musique soul et au rock, tandis que les aficionados plus âgés se détournaient
de l'abstraction et de la froideur émotionnelle d'une grande partie du jazz
moderne. Les musiciens de jazz réalisèrent que, pour reconquérir leur public,
ils devaient emprunter des idées à la musique populaire. Certaines provenaient
du rock, mais la plupart furent tirées des rythmes de danse et des progressions
harmoniques de musiciens soul tels que James Brown. Certains groupes
introduisirent également des éléments musicaux provenant d'autres cultures. Les
premiers exemples de ce nouveau jazz «fusion» rencontrèrent un succès inégal
mais, en 1969, Davis enregistra Bitches Brew, un album
très apprécié, qui associait des rythmes de soul et des instruments
électroniquement amplifiés pour produire un jazz hautement dissonant, sans compromis.
Rien d'étonnant donc à ce que certains des enregistrements de fusion les plus
réussis des années 1970 émanent d'anciens élèves de Davis : Herbie Hancock, Wayne Shorter et le pianiste d'origine autrichienne Joe Zawinul, co-leaders de
l'ensemble Weather Report; le
guitariste anglais John McLaughlin,
le brillant pianiste Chick Corea et
son groupe Return to Forever. À leur
tour, les musiciens de rock commencèrent à imiter, sur un rythme de rock, le
phrasé et les solos du jazz. Parmi ces groupes : Chase, Chicago et Blood Sweat and Tears.
Miles Davis : le second souffle
En 1969, Miles Davis entre en studio avec le
guitariste anglais Jogn McLaughlin. Le trompettiste vient de vivre une période
de déstabilisation métrique, de dramaturgie prostrée, de nihilisme lumineux et
contemplatif, toute une remise en cause climatique (harmonique et rythmique)
amorcée avec les claviers de herbie Hancock et de Chick Corea, le saxophoen de
Wayne Shorter, les basses de Dave Holland et de Ron Carter, la batterie de Tony
Williams. Dès 1967, il a déjà perçu de façon intuitive les bouleversements à
venir :
"J’évoluais déjà vers un son de guitare. J’ai
toujours aimé le blues, j’adore le jouer. A cette époque, j’écoutais donc Muddy
Waters, B.B. King et je cherchais un moyen d’introduire ce type de voicing dans
ma musique. J’avais beaucoup appris de Herbie, Tony, Wayne et Ron, et je venais
juste d’absorber tout ce que je leur avais pris au cours des presque trois
années que nous avions passées ensemble. Je pensais maintenant à d’autres
manières d’approcher ma musique. Je sentais naître un désir de changer, mais je
ne savais pas encore en quoi consistait ce changement. Je savais que ça avait
quelque chose à voir avec la guitare."
|
|
|
|||||
|
1969 In a silent way |
1969 Bitches Brew |
Tribute to Jack Johnson |
1972 On The Corner |
1981 The Man with the horn |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1986 Tutu |
1989 Aura |
1992
Doo-bop |
|
|
|
Les enfants de
Miles
"Les musiciens étaient bien payés pour les séances d’enregistrement, et jouer avec moi leur faisait une sacrée réputation. Je frime pas, c’était comme ça. On joue avec moi, puis on devien leader, parce qu’après, tout le monde le dit, c’est tout ce qu’il vous reste à faire. C’est flatteur, mais je ne l’ai pas cherché. Et je n’ai eu aucun problème à accepter ce rôle"
A la direction de leurs formations personnelles, ces artistes de haut vol ont fait fructifier l’expérience du jazz-rock entamée sous la férule de Miles. Certains reviendront parfois à des préoccupations musicales plus classiques, alternant instrumentations accoustiques et électriques, mais tous garderont en souvenir des leçons de leur ancien leader. Le 8 juillet 1991 à Montreux et le 10 à Paris, deux concerts de prestige ont permis à Miles Davis de voir défiler sur scène une cinquantaine de musiciens qui avaient joué avec lui durant les décennies précédentes.
|
|
|
|
|
|||||||
|
Chick Corea |
1972 Return Forever |
Hymn of the Seventh Galaxy |
1975 No Mistery |
1976 Romantic Warrior |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Herbie Hancock |
1972 Sextant |
1973 Heaf Hunters |
1974 Thrust |
1975 Manchild |
|
|
|
|||
|
|
||||||||||
|
1971 Inner Mounting Flame |
1973 Birds of fire |
Visions of Emerald Beyond |
1975 Shakti |
1977 Natural elements |
1977 A handful of beauty |
|||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
1978 Electric guitarist |
1979 Electric dreams |
1983 Passion, Grace & Fire |
2003 Thieves and Poets |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Tony Williams |
1964 Lifetime |
|
|
|
|
|
||||
Weather Report:
beau fixe
A la suite des premières secousses sismiques du
jazz-rock, déclenchées et activées par Miles Davis, qui dommine les
fluctuations du temps et plaît à dire : "chaque fois que la météo
change, votre comportement s’en trouve modifié", deux transfuges de l’observatoire
davisien vont se réunir pour monter, vers la fin de 1970 le groupe le plus
explosif et le plus emblématique de la fusion. Lorsque le pianiste-claviériste Joe
Zawinul et le saxophoniste Wayne Shorter décident de fonder le
groupe Weather Report (bulletin météo), ils s’adjoignent une superbe
section rythmique avec le bassiste Miroslav Vitous, le batteur Alphonse
Mouzon et le percussioniste Airto Moreira.
|
|
|
|
|
|
||
|
Jaco Pastorius |
1975 Jaco |
1976 Jaco Pastorius |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Weather Report |
I Sing the Body Electric |
1971 Weather report |
1974 Mysterious Traveller |
1976 Black Market |
1977 Heavy Weather |
1978 Mr Gone |
|
|
|
|
|
|
||
|
Joe Zawinul |
1986 Dialects |
1996 My people |
|
|
|
|
Les maîtres de forge
Art de l’absorption, de la concentration, de
l’intégration ou de l’assimilation, le jazz fusion va révéler des solistes de
qualité qui s’extrairont peu à peu d’un creuset musical où se liquéfient, se
fondent, se confondent, se cristallisent, se réduisent ou se solidifient tous
les alliages stylistiques. Jazz électrique et binaire, avec parfois
d’épisodiques allers-retours vers le ternaire et des incursions résurgentes
vers le son acoustique, la fusion brasse une coulée de matières ardentes et
plonge dans le même moule les effusions caribéennes, les langueurs latines, les
pulsions africaines, les vapeurs extrême-orientales, les braises rageuses du
rock et les rigueurs pointillistes occidentales.
|
|
|
|
|
|||
|
Mickael Brecker |
1988 Don’t try this at |
2007 Pillgrimage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pat Metheny |
1981 Offramp |
1989 Question and answer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jean-Luc Ponty |
1978 Cosmic Messenger |
|
|
|
|
|
ECM:
éthique de l’esthétique
Avec
l’apparition du label allemand ECM (Editions of Contemporary Music), c’est
avant tout une pholisopjie nouvelle qui va redistribuer les cartes sur un marché
souvent embrouillé. Fondée par Manfred Eicher en 1969, ette compagnie
indépendante b&sée à Munich va redéfinir les lois de la production en
proposant un nouveau type de relations avec les atistes et en manifestant un
respect scrupuleux pour le public. Paradoxalement, le fameux slogan "ECM,
le plus beau son après le silence" va quelque peu dénaturer l’image d’une
entreprise qui pourtant ne se limite pas à une conception figée du son
(faussement perçu comme une uniformisation esthétique).
Keith Jarrett,
Didier Lockwood,
Wayne Shorter,
Grover Washington,