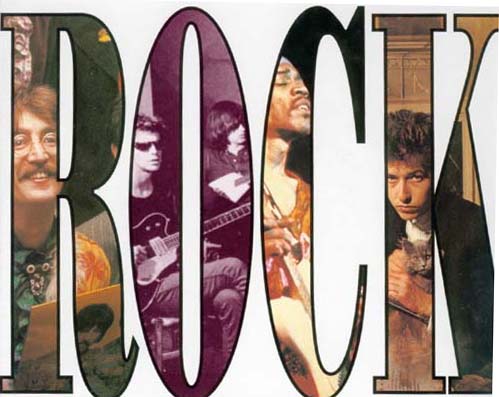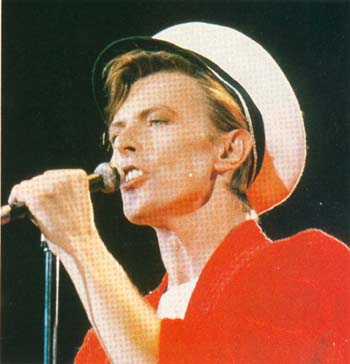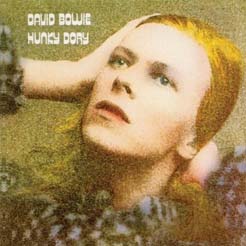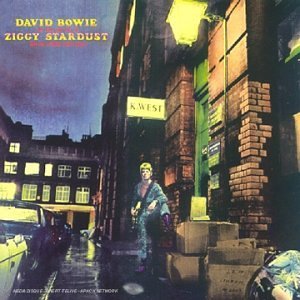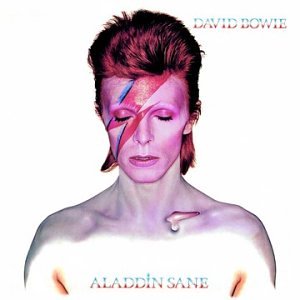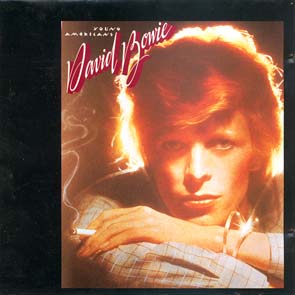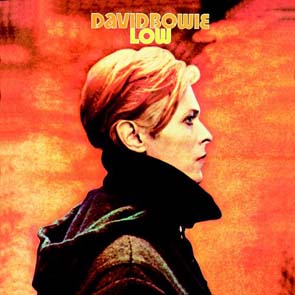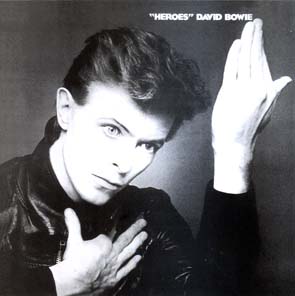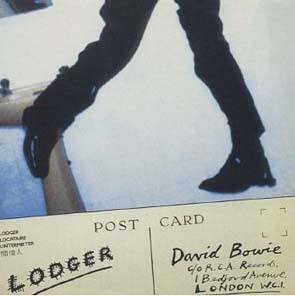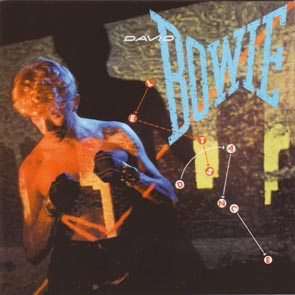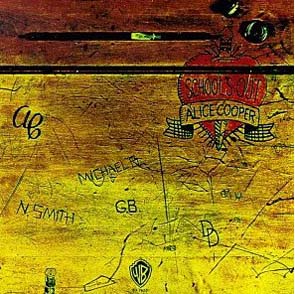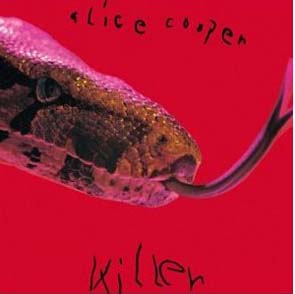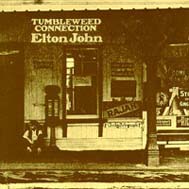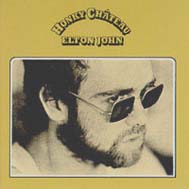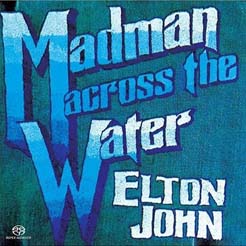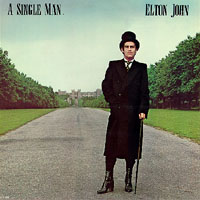|
|
|
STORY
au néo-paganisme : le glam rock |
Agacé par les attitudes paupiéristes des
hippies, le rock réagit. Il redécouvre le strass et les paillettes. Les
mouvements de libération de la fin des années soixante ont aussi leurs
incidences sur les codes vestimentaires. Les rôles sexuels se confondent. Les
filles s'habillent comme des garçons, tandis que ceux-ci se maquillent et se
teignent les cheveux. Prophète de cette ambivalence, David Bowie passe
d’abord pour un extra-terrestre, avant d’être largement imité. Inspiré par son
professeur, le mime Lindsay Kemp, et par le poète et comédien Quentin Crisp, il
affiche une bisexualité, qui en 1972, peut encore choquer. Ses diverses
incarnations - en Ziggy Stardust, Alladin Sane, ou Thin White Duke – sont
autant de masques. D’autres les emprunteront, sitôt délaissés.
Au début des années 70, le chemin du rock
ne croise plus celui de la pop depuis un bon moment déjà. L’urgence, l’art du
single, le souci de divertir ou de faire danser se sont perdus dans les brumes
du psychédélisme et du blues boom. La chanson n’est plus qu’un maigre prétexte
pour se lancer dans d’interminables solos de guitare ou de longues errances
expérimentales dominées par les claviers et les premiers synthétiseurs. Pour
une poignée d’artistes britanniques, généralement des galériens des années 60 à
qui la chance n’a guère souri, le rock fait évidemment fausse route. Leur
ambition ? Faire revenir le binaire dans les discothèques et les bars, le
reprendre aux mains des étudiants et des intellectuels pour le rendre au
peuple. La méthode ? Repartir aux sources en quête de la matière
originelle, le rock’n’roll, puis s’habiller de strass et de paillettes pour lui
offrir une seconde jeunesse : T. Rex, David Bowie, Slade,
Gary Glitter, Sweet … Ils seront nombreux à troquer leurs mornes
jeans et leur tuniques informes pour enfiler des tenues aussi provocantes que
délirantes – costume doré et kimono moulant, chemise à col pelle à tarte aux
couleurs bigarrées et platform boots aux talons démesurés – pour incarner ces
nouvelles idoles au look androgyne….
|
|
|
|||||
|
Hunky Dory |
Ziggy Stardust |
Aladdin Sane |
Diamond Dogs |
Young Americans |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Low |
Heroes |
Lodger |
Let’s Dance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Killer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dans la première moitié des seventies, les véritables
artisans de l’explosion punk à venir sont déjà à l’œuvre. A New York, un petit
club pouilleux, le CBGB’s est investi par des rockers d’un genre nouveau,
enfants illégitimes du Velvet Underground. Patti Smith, Television,
les Talking Heads, Blondie partagent, plus que leur musique, le
même look famélique, la même élégance miteuse, le même regard menaçant. Et
puis, il y a les Ramones. Quatre faux frères, crétins autoprolamés, aux
têtes de dégénérés – teints blafards et lunettes noires – portant jeans troués
et baskets éclatées. Leurs chansons se ressemblent toutes et tiennent en moins
de deux minutes chrono : point de solo inutile ou de prouesses musicales à
exhiber, juste un rock brutal réduit à une expression minimale. En même temps,
Richard Hell, bassiste du groupe américain Television, se coupe les
cheveux courts et lacère ses T-shirts, qu’il rafistole avec des épingles à
nourrice. Le style punk est né. Malcom Mc Laren, le manager-styliste anglais
n’en perd pas une miette…